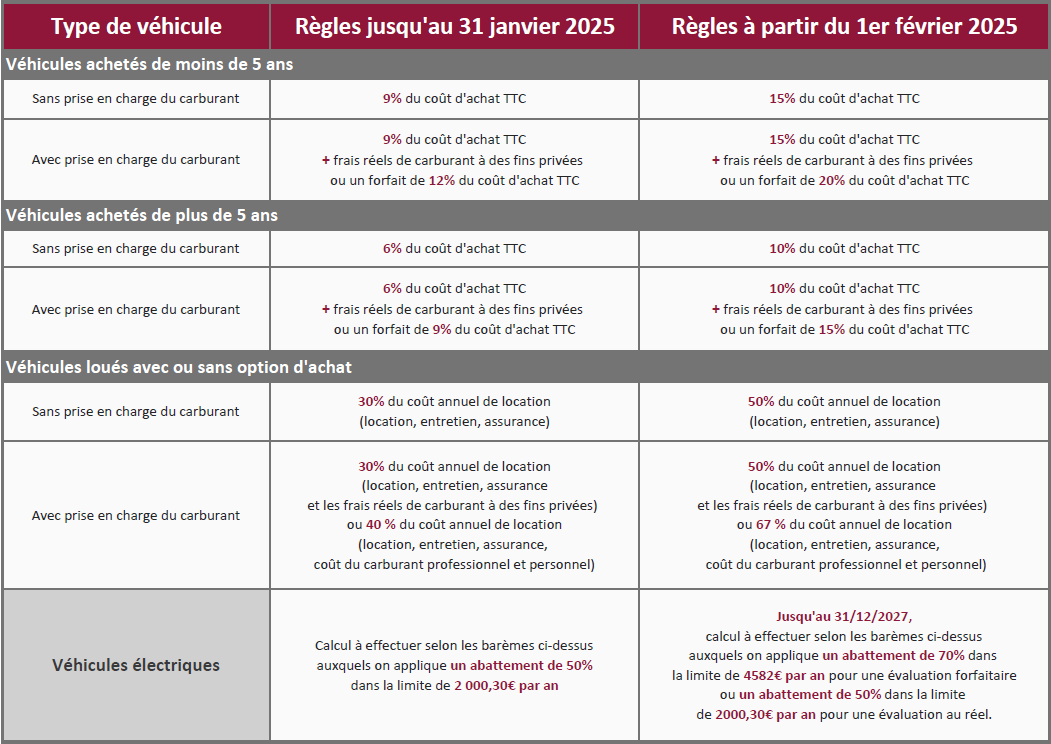Vous souhaitez embaucher un mineur pendant la période estivale ?
Voici les principales règles à respecter !
> Âge d’admission au travail
1 – Principes généraux
- En règle générale, un mineur doit avoir atteint 16 ans pour pouvoir être employé (articles L. 4153-1 et suivants du Code du travail).
- Exception « vacances scolaires » : il est possible de recruter un mineur dès 14 ans révolus pendant ses congés scolaires, sous réserve de respecter des conditions plus strictes (article L. 4153-5).
2 – Sanctions en cas de non-respect de l’âge minimal
- Amende de 1 500 € pour une personne physique employeur.
- Amende de 7 500 € pour une personne morale (société, association, etc.).
> Formalités préalables à l’embauche
1 – Autorisations nécessaires
- Mineurs de moins de 16 ans (14–16 ans)
- Autorisation parentale écrite obligatoire : l’un des représentants légaux (père, mère ou tuteur) doit adresser une autorisation écrite pour que l’employeur puisse embaucher le mineur.
- Autorisation de l’inspecteur du travail :
- À solliciter au moins 15 jours avant la date d’embauche prévue.
- L’inspection du travail vérifie notamment que les conditions d’hygiène, de sécurité et d’encadrement sont satisfaisantes.
- Mineurs de 16 à 18 ans
- Autorisation parentale facultative : si le mineur est âgé de 16 ans révolus, l’autorisation des parents n’est plus strictement exigée par le Code du travail, mais elle reste vivement recommandée pour éviter tout litige (et parfois exigée par la convention collective).
- Pas d’autorisation de l’inspecteur du travail pour les 16-18 ans, sauf cas particuliers.
- Mineurs de moins de 16 ans (14–16 ans)
2 – Visite médicale
- Obligation : avant la prise de poste, le mineur doit passer une visite d’information et de prévention auprès du service de santé au travail (médecine du travail).
- Pour les moins de 16 ans, cette visite doit être programmée avant chaque entrée en service, même pour un contrat de courte durée.
- Pour les 16–18 ans, la visite est également obligatoire avant affectation, puis renouvelée selon les échéances définies par la médecine du travail (généralement tous les ans ou tous les deux ans).
- Obligation : avant la prise de poste, le mineur doit passer une visite d’information et de prévention auprès du service de santé au travail (médecine du travail).
⇒ Conseils pratiques
- Bien anticiper l’organisation de la visite : la période estivale est chargée pour les services de santé au travail, prévoyez de prendre rendez-vous dès que possible.
- Conserver précieusement les justificatifs de passage afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle de l’Inspection du travail.
> Conditions de travail et hygiène/sécurité
1 – Interdiction d’exposer le mineur à des risques
- Travaux interdits à tous les mineurs (article D. 4163-1 du Code du travail) :
- Travaux exposant à des agents chimiques dangereux, bruits intenses, rayonnements ionisants, etc.
- Utilisation de machines dangereuses (sirops, presses, turbines, etc.), d’outils tranchants ou motorisés (hors activité sous surveillance particulière)
- Manutentions manuelles de charges lourdes
- Travaux en milieu hyperbare (caissons) ou en profondeur (souterrain)
- Travaux en atmosphère confinée
- Travaux sur les chantiers du BTP (sauf dérogation très encadrée)
- Travaux interdits à tous les mineurs (article D. 4163-1 du Code du travail) :
2 – Durée du travail et repos quotidien
Les règles sont distinctes selon l’âge du mineur :
Âge du mineur | Durée quotidienne maximale | Durée hebdomadaire maximale | Temps de repos quotidien minimal | Horaires interdits |
Moins de 16 ans (14–16 ans) | 7 heures par jour | 35 heures | 12 heures consécutives | Pas de travail avant 7 h ni après 21 h |
16–18 ans révolus | 8 heures par jour | 35 heures | 12 heures consécutives | Pas de travail avant 6 h ni après 22 h |
- Mineurs 14–16 ans (période de vacances scolaires)
- Maximum 7 heures de travail effectif par jour
- Maximum 35 heures par semaine (calculé sur une même semaine civile)
- Interdiction de travailler avant 7h et après 21h.
- Toute pause d’au moins 30 minutes pour 4 heures de travail consécutif
- Mineurs 16–18 ans
- Maximum 8 heures de travail effectif par jour
- Maximum 35 heures par semaine
- Interdiction de travailler avant 6h et après 22h, sauf dérogations (ex. : secteur agricole, spectacles), mais ces dérogations sont très encadrées
- Pause d’au moins 30 minutes pour 4 heures 30 minutes de travail consécutives
- Attention particulière : repos hebdomadaire
- Le jeune doit bénéficier de deux jours de repos consécutifs (généralement le dimanche et un autre jour), sauf dérogation spécifique pour certains secteurs (hôtellerie-restauration, etc.).
- Mineurs 14–16 ans (période de vacances scolaires)
> Rémunération des mineurs
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, le salaire des mineurs est déterminé en pourcentage du SMIC.
Les taux varient selon l’âge et l’ancienneté :
Tranche d’âge | Ancienneté dans l’entreprise | Pourcentage du SMIC minimum |
Moins de 17 ans | Jusqu’à 6 mois | 80 % |
Plus de 6 mois | 90 % | |
17–18 ans révolus | Jusqu’à 6 mois | 90 % |
Plus de 6 mois | 100 % |
> Dispositions particulières selon le secteur d’activité
Certaines activités soumises à convention collective ou réglementation spécifique imposent des règles additionnelles.
1 – Hôtellerie-restauration (C.C.N. HCR)
- Horaires de travail plus larges (fin possible à 23h pour les plus de 16 ans, sous conditions).
- Dérogations possibles à l’interdiction du travail dominical, notamment pour les établissements de plage, les hôtels, etc.
2 – Agriculture
- Possibilité de faire travailler plus tôt certains mineurs (dès 14 ans) dans le cadre d’activités agricoles pendant les récoltes, avec autorisation préfectorale et respect de conditions sanitaires et de sécurité renforcées.
- Horaires décalés liés aux saisons agricoles (récoltes matinales, travaux en plein air).
3 – Commerce de détail
- Travail possible jusqu’à 22h pour les 16–18 ans, si l’établissement ferme à cette heure (sous réserve d’autorisation du préfet).
> Sanctions en cas de non-respect
Le non-respect des règles relatives à l’emploi des mineurs peut donner lieu :
1 – Sanctions pénales et administratives
- Amendes
2 – Possibilité de fermeture administrative de l’établissement pour travail illégal
Les règles à respecter concernant l’embauche et le travail de mineurs sont nombreuses : leur non-respect est passible de sanctions.